Après le renversement du gouvernement du premier président indonésien Soekarno et la prise du pouvoir par les militaires en 1965, près d’un million d’Indonésiens ont été assassinés. Cela s’est produit sur une période d’un an dans l’archipel. Le motif invoqué était leur appartenance ou leur sympathie pour le PKI, le Parti Communiste Indonésien. C’était le plus grand parti communiste au monde en dehors d’un pays communiste. Pour éviter de se salir les mains et probablement pour des raisons logistiques, l’Ordre Nouveau a brillamment recruté des civils. Il les a convaincus du danger que représentaient ces communistes pour l’intégrité de l’État. Cela sous-entendait la dictature militaire de Suharto. Le régime a fait en sorte que chacun craigne pour son pays. Il a incité les citoyens à s’approprier cette cause patriotique et à prendre des mesures draconiennes pour « le bien » de l’Indonésie. C’est ainsi que ces civils se sont organisés en groupes paramilitaires. Ils ont arrêté et torturé des milliers d’innocents, incluant des membres de syndicats et coopératives, des paysans sans terre, des intellectuels et des Chinois. Ils ont procédé à leur exécution dans des conditions absolument atroces. Cet article explore le Génocide Indonésie The Look of Silence, un documentaire essentiel sur cette période sombre.
Jeudi 17 septembre, le cinéma du Panthéon accueillait la seconde avant-première du documentaire The Look of Silence. Ce film est une sorte de miroir de The Act of Killing, sorti en 2012. Ce premier documentaire traitait déjà de l’héritage du génocide de 1965. Alors que le premier volet donnait la parole aux bourreaux et exposait une société construite sur le mensonge, The Look of Silence donne la parole aux victimes de ces massacres de masse. Il révèle les conséquences de 50 ans de silence et de terreur.
Joshua Oppenheimer : Un réalisateur engagé en Indonésie

Joshua Oppenheimer arrive en Indonésie en 2003. Il vient alors pour enseigner aux agriculteurs comment réaliser un film. Ce film devait montrer leur lutte quotidienne après la dictature. Il sortira d’ailleurs en 2002 sous le titre « The Globalisation Tapes« . Pendant ce séjour, dans une plantation d’huile de palme belge nommée « Société Financière » au nord de Sumatra, il constate un problème majeur. De nombreux travailleurs ne disposent d’aucun équipement pour se protéger de la toxicité des produits qu’ils utilisent. Lorsqu’il leur demande pourquoi ils ne se réunissent pas en syndicat pour en parler à leurs responsables, il s’aperçoit de leur peur. Ces paysans vivent en effet dans la crainte continuelle que les événements du passé se reproduisent. De plus, l’entreprise employait déjà des groupes paramilitaires pour faire régner l’ordre dans la plantation, ce qui autorisait des brutalités.
Ce qui devait être un court séjour d’enseignement prend alors une toute autre tournure dans la vie de Joshua. Il consacrera toute sa jeunesse à faire la lumière sur des événements jamais jugés ni portés à la connaissance de la communauté internationale. Pendant 10 ans, Joshua rencontre et interviewe les bourreaux. Il écoute le récit de ce qu’ils considèrent comme le plus grand accomplissement de leur vie. Malgré les intimidations des autorités locales, Joshua ne lâche pas son projet. Les familles de victimes l’encouragent, voyant en lui un vecteur de communication inespéré. Dix ans de tournage, des milliers d’heures d’images, et un montage d’une justesse exceptionnelle.
Analyse du documentaire The Look of Silence
Adi, père de deux enfants, est opticien itinérant à Sumatra. Ses parents ont eu un fils avant lui, Ramli. Ce dernier a été emprisonné, torturé et froidement exécuté dès 1965. Sa mère, Rohani, ne s’est jamais remise de la perte de cet enfant. Son père, Rukun, a quant à lui simplement perdu la mémoire. La naissance d’Adi a probablement sauvé sa mère du désespoir. Cette naissance, dans un contexte familial lourd et politique ultra-rigide, a forgé le besoin de vérité d’Adi. Il aspire à la reconnaissance du génocide au plus haut niveau, au vivre-ensemble et à la réconciliation entre Indonésiens.
![[Documentaire] The Look of Silence où le siècle de l'impunité - Balisolo (2)](https://balisolo.com/wp-content/uploads/2015/09/Documentaire-The-Look-of-Silence-où-le-siècle-de-limpunité-Balisolo-2-960x540.jpg)
Dans ce documentaire, nous suivons Adi lors de ses consultations ophtalmologiques. Il rencontre également les acteurs du génocide, les donneurs d’ordre. Parmi eux, des notables, des politiques, des élus et même certains membres de sa famille. Adi les questionne de façon neutre, en utilisant le bon sens. Né après la période la plus macabre de la dictature, il n’a pas peur de poser les questions et d’exiger des réponses. Il cherche à comprendre, à rétablir la vérité. Je pense aussi qu’il veut confronter les bourreaux à l’ignominie de leurs crimes. Il souhaite leur faire réaliser l’horreur de leurs actes. Peut-être tente-t-il aussi, en vain et sans jamais l’excuser, de démontrer la manipulation dont ces milices d’hier et notables d’aujourd’hui ont aussi été victimes.
![[Documentaire] The Look of Silence où le siècle de l'impunité - Balisolo (9)](https://balisolo.com/wp-content/uploads/2015/09/Documentaire-The-Look-of-Silence-où-le-siècle-de-limpunité-Balisolo-9-960x540.jpg)
L’impunité et la réécriture de l’histoire
Le problème est là : l’immense majorité des personnes impliquées dans le génocide n’avaient pas conscience de faire quelque chose de mal. Pour elles, il s’agissait de défendre leur pays en éradiquant la menace communiste. On leur avait promis une belle récompense pour ces actes patriotiques. Ils ne s’en sont jamais cachés. Cela s’est avéré payant, puisque tous vivent confortablement. Ils sont craints et respectés dans leurs communes. L’Histoire, malheureusement, entretient cette petite gloire et notoriété. Elle n’a pas su rétablir le sens et la vérité des faits, bien au contraire. L’Ordre Nouveau de Suharto a pris le plus grand soin à réécrire et transmettre SA version, SA justification des faits auprès de sa population.
Dans The Look of Silence, on assiste même à un cours d’histoire indonésienne. Cela se passe à l’école primaire ou au collège. Le professeur y raconte, au moyen d’anecdotes et de manière un peu théâtrale, à quel point les communistes étaient des êtres maléfiques. Il les décrit comme sans foi ni loi, amoraux, violents et dangereux. C’est une parfaite justification de l’action du gouvernement d’alors. C’est incroyable et horrifiant que ce génocide soit encore glorifié aujourd’hui. Nous sommes en 2014 au moment de ce cours. On se demande quand les manuels scolaires seront enfin réécrits.
![[Documentaire] The Look of Silence où le siècle de l'impunité - Balisolo (6)](https://balisolo.com/wp-content/uploads/2015/09/Documentaire-The-Look-of-Silence-où-le-siècle-de-limpunité-Balisolo-6-960x540.jpg)
Heureusement, la sortie de The Act of Killing et son appropriation par les médias ont rendu possible la reconnaissance orale du génocide. Le porte-parole du gouvernement indonésien l’a notamment reconnue. De plus, des professionnels de l’enseignement et des universitaires ont déjà rédigé des cours alternatifs. Ils sont destinés aux lycéens et étudiants. Ces cours seront diffusés dès l’année prochaine. Ils prendront la forme d’un exposé critique, comparant ce qu’on leur demande d’étudier et la vérité des faits. Ces exposés seront accompagnés de la diffusion de The Act of Killing et The Look of Silence.
La diffusion des documentaires : Un mouvement pour la vérité
Grâce au premier documentaire, vu près d’un million de fois (à l’époque, il était accessible gratuitement dans toute l’Indonésie sur internet), un mouvement pour la vérité est né en Indonésie. The Act of Killing a réveillé les consciences. Il a touché une audience suffisamment large pour donner un écho encore plus grand à The Look of Silence. Même s’il n’est pas envisageable que ces documentaires connaissent d’aussi grandes sorties commerciales qu’en Europe, on peut tout de même compter sur les ciné-clubs et les universités pour les diffuser. Aujourd’hui, près de 4 000 projections ont
En savoir plus sur Balisolo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



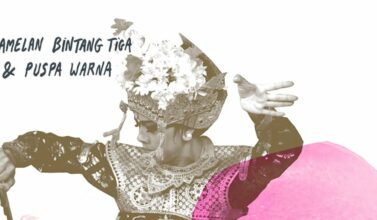
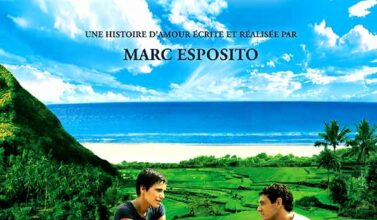

Commenter l'article